
Que faire des « meurtriers » et des « personnes vraiment dangereuses » ? Que faire des « violeurs » ? Est-ce que l’abolition du système pénal ça veut dire qu’il ne reste que le chaos et « la loi du plus fort » ? Voilà des questions auxquelles les abolitionnistes sont fréquemment confronté·e·s. Pour y répondre nous republions ici un court extrait du récent et excellent ouvrage Brique par brique, mur pas mur – Une histoire de l’abolitionnisme pénal.
Que faire des « meurtriers » et des « personnes dangereuses » ?
L’argument de la menace des « personnes dangereuses» est souvent opposé aux abolitionnistes. Il renvoie notamment aux figures qui peuplent I ‘imaginaire sensationnaliste du crime, comme le « tueur en série » ou le « délinquant sexuel multirécidiviste ». Cette crainte légitime, qui préoccupe I ‘abolitionnisme depuis ses origines, a historiquement servi de justification ultime à l’existence du système pénal, alors qu’il constitue un échec coûteux, injuste et immoral.
Une réponse abolitionniste classique a donc souvent consisté à rappeler que les personnes dangereuses ne constituent qu’une infime minorité des personnes criminalisées, et que cela ne devrait pas légitimer le traitement du reste des personnes criminalisées et souvent issues des segments les plus désavantagés de la société.
Une autre réponse, moins élusive et plus critique, vise à contester l’approche du système pénal et son efficacité en matière de dissuasion, de détection et de prise en charge des « personnes dangereuses ». La plupart des « crimes de sang » ne sont pas le fait de personnes tuant de manière aléatoire, mais s’inscrivent souvent dans des conditions sociales et économiques désespérées et dans des cycles de violences préexistants. Exceptionnels (avec un taux de récidive parmi les plus bas), ces crimes touchent en général non des victimes inconnues, mais des proches de leur auteur et ils répondent à des dynamiques complexes de violences familiales et relationnelles.
En n’agissant pas sur les causes mais sur les symptômes, non seulement les institutions pénales n’empêchent pas et ne résolvent pas ces problèmes, mais elles tendent au contraire à les exacerber. Comme le rappelle le juriste étatsunien Dean Spade, la police et la prison sont elles-mêmes des « tueuses en série ». Si les abolitionnistes s’accordent sur l’inefficacité de la coercition comme réponse durable et sur la nécessité d’agir collectivement sur les racines sociales des atrocités pour les prévenir, il n’existe en revanche pas de consensus sur les réponses plus immédiates à apporter. Il y a en particulier des débats sur l’opportunité du recours à la contrainte ou à la mise à l’écart, et sur la durée et la forme que ces mesures devraient prendre selon les cas. Pour une partie des abolitionnistes, une société doit se laisser la possibilité, dans certaines situations, d’y recourir. Pour d’autres, celles-ci ne constituent pas une réponse viable et il convient de privilégier des dispositifs communautaires inclusifs avec des pratiques de guérison, de responsabilisation et de justice transformatrice. Dans tous les cas, il faut garder à l’esprit que l’absence de risque et les solutions parfaites n’existent pas.
Une dernière réponse abolitionniste courante consiste à problématiser la notion même de dangerosité. La conception libérale de la dangerosité véhiculée par le système pénal se focalise sur les formes les plus visibles, interpersonnelles, intentionnelles et directes de violence et occulte les formes de préjudices sociaux les plus endémiques et dévastatrices. En outre, en surcriminalisant les groupes sociaux et ethnoraciaux les plus dominés, le système pénal tend à les stigmatiser comme « dangereux » sur la base des relations de domination qui structurent la société. Si l’on veut réellement protéger les individus des préjudices qui menacent les besoins fondamentaux et la vie des êtres humains, il faut admettre que les préjudices que le système pénal considère et traite sont relativement insignifiants. C’est en tout cas vrai si on les compare aux violences et aux souffrances que produisent, de manière systématique et souvent légale, les structures étatiques et économiques.
Les abolitionnistes insistent donc sur la violence structurelle et institutionnelle de tout un ensemble de préjudices sociaux (d’ordre physique, psychologique, économique, culturel, environnemental), en principe évitables.
Une représentation réaliste de la dangerosité devrait donc moins prendre l’image d’un « psychopathe » agressant aléatoirement des individus que celle, plus ordinaire, de décideurs politiques et économiques en costumes réunis autour d’une table pour (ne pas) prendre des mesures qui, par leur échelle et leur portée, auront des conséquences directes et indirectes sur la vie de populations entières et sur une longue période. Il ne s’agit pas simplement de considérer les formes les plus flagrantes de crimes d’État (corruption, guerre, génocide, torture, violence de la police et de la prison, pillage organisé des ressources, etc.) et de crimes économiques (infractions financières, infractions contre les consommateurs, les travailleurs, l’environnement, etc.). Il faut aussi envisager tout un ensemble de politiques et de (contre-) réformes inégalitaires qui négligent des communautés entières, détériorent l’accès aux ressources économiques et sociales, à la santé ou au logement et s’inscrivent dans le capitalisme, le racisme systémique, le patriarcat et le validisme, notamment.
Les catégories de « crime » et de « dangerosité » utilisées par le système pénal ne sont donc pas neutres. En se focalisant sur les comportements individuels des populations les plus vulnérables et en ignorant les (in)actions collectives préjudiciables des dominants, elles jouent un rôle fondamental dans le maintien des rapports de pouvoir existants et entérinent le fait que certaines vies sont sacrifiables. Dans une perspective abolitionniste, plutôt que d’investir dans des institutions pénales coûteuses qui se focalisent sur une minorité de personnes prétendument dangereuses, il faudrait donc identifier l’ensemble des structures, des politiques et des pratiques nuisibles pour les êtres humains, pour s’attaquer à leurs causes profondes et pour créer des structures sociales capables de responsabiliser autant les personnes que la société dans son ensemble.
Que faire des « violeurs » ?
Cette question, très liée à la précédente, est constamment posée aux abolitionnistes. Elle découle souvent d’une vision fausse de l’efficacité du système pénal pour répondre aux préjudices sexuels. En fait, la figure du « violeur » sert souvent à légitimer le système pénal et le durcissement des politiques pénales.
Les réponses pénales sont rarement satisfaisantes pour les victimes de préjudices sexuels. Les procédures sont généralement longues, incertaines et traumatisantes. Entre le dépôt de plainte, l’enquête judiciaire, le procès et la condamnation de l’auteur, les obstacles sont multiples. Pour différentes raisons, très peu d’affaires aboutissent à une condamnation et, même dans ce cas, rares sont les victimes qui s’en satisfont. La procédure pénale les met à l’épreuve, en ravivant parfois des traumatismes, en imposant ses catégories réductrices et en mettant en doute leur parole. En se focalisant sur la culpabilité de l’auteur à des fins répressives, elle ne répond généralement pas à leurs besoins de protection, de reconnaissance et de reconstruction.
L’approche punitive ne s’avère pas plus utile pour l’infime minorité de personnes condamnées. Les procédures judiciaires ne favorisent pas la responsabilisation et la transformation des personnes : elles participent à perpétuer et à renforcer le cycle de violences sexuelles. Compte tenu de la violence patriarcale qui les caractérise, les institutions pénales sont, comme le souligne Dean Spade, elles-mêmes des « agresseuses sexuelles ». Par ailleurs, les procédures judiciaires pour viols surcriminalisent les personnes non blanches et issues des classes populaires. Ainsi, le système pénal instrumentalise les victimes de préjudices sexuels pour se légitimer, alors qu’il participe lui-même au problème et qu’il renforce l’ordre socioéconomique inégalitaire, le patriarcat et le racisme systémique.
Les préjudices sexuels existent pourtant dans tous les milieux, toutes les classes sociales et toutes les cultures. La recherche et les mouvements féministes, comme le récent #MeToo, ont montré le caractère systémique du phénomène, que les institutions pénales ne saisissent qu’à la marge. Ainsi, ce ne sont pas seulement l’essentiel des personnes accusées judiciairement d’avoir causé des préjudices sexuels qui n’ont jamais à répondre de leurs actes, mais bien l’écrasante majorité des personnes qui en commettent. En clair, la quasi-totalité des « violeurs » sont déjà en liberté. Cela témoigne du caractère faiblement dissuasif du système pénal et du fait que son approche individualisante et dépolitisante l’empêche de comprendre les logiques sociales et structurelles des préjudices sexuels et d’y répondre adéquatement.
L’écrasante majorité des auteurs de préjudices sexuels ne sont pas des inconnus violents et dangereux, mais font partie des proches de la victime. C’est l’une des raisons pour lesquelles les institutions pénales sont si peu sollicitées. La plupart du temps, les préjudices sexuels — si tant est qu’ils soient perçus comme tels par leurs victimes — font l’objet d’un arrangement infrajudiciaire, ou n’aboutissent tout simplement à aucune forme de résolution. Les préjudices sexuels doivent être compris non comme des actes commis par des individus déviants, mais comme le produit de rapports de domination, liés au genre, à la classe, à la race, à l’âge et au handicap notamment. Ils s’ancrent également profondément dans la « culture du viol » qui minimise, banalise, voire encourage, les violences faites aux femmes et aux enfants.
À long terme, les luttes abolitionnistes doivent donc viser à transformer ces structures sociales pour prévenir ces violences. À court et moyen terme, il faut précisément faire ce que le système pénal ne fait pas : partir de l’expérience et des besoins des personnes impliquées, créer des refuges pour les victimes, répondre à leurs urgences économiques et psychiques, et proposer, le cas échéant, des modes de résolution basés sur la réparation, le dialogue et la responsabilité individuelle et collective. Cela fait maintenant plusieurs décennies que des groupes de nombreux pays travaillent à l’élaboration de pratiques de responsabilisation et de justice restauratrice et transformatrice qui essaient de réparer les préjudices causés par les agressions sexuelles et de transformer non seulement les individus impliqués, mais aussi les communautés et la société.
L’abolition du système pénal ne favoriserait-elle pas l’avènement d’une société où règnerait la « loi du plus fort « ?
En dehors des figures spécifiques du « crime » évoquées dans les questions précédentes, la perspective de l’abolition du système pénal laisse aussi souvent craindre que règne alors la « loi du plus fort ». Dans les formulations les plus progressistes, on redoute que l’abolition mène à une forme de gouvernementalité libérale, où la police et la justice seraient exercées directement par les individus, donnant lieu à un contrôle social informel plus arbitraire et inégalitaire, qui favoriserait les méfaits des dominants. Les institutions pénales se présentant historiquement souvent comme un « tiers neutre », leur suppression peut laisser présager l’avènement de formes de police ou de justice privées, violentes, vengeresses et punitives.
Il faut d’abord souligner que diverses formes de pénalité violentes, expéditives et extrajudiciaires, exercées par des citoyens ordinaires qui exigent une répression plus sévère, existent déjà dans les sociétés actuelles où le système pénal fonctionne à plein régime. Ces mobilisations sécuritaires entretiennent souvent des rapports ambigus avec les autorités, entre défiance et connivence, et vont de pair avec les politiques néolibérales. L’abolitionnisme n’a rien à voir avec le vigilantisme, qui ne critique pas le système pénal sur la base de son fondement et de ses fonctions sociales, mais se contente de condamner son manque de vigueur. Autrement dit, le vigilantisme reproduit les mythes propagés par le système pénal et il partage sa logique et son projet de maintien de l’ordre économique, social, racial et sexuel. L’abolitionnisme permet précisément de montrer aux personnes tentées par l’autodéfense punitive qu’il est possible de développer une vue d’ensemble qui débouche sur de meilleurs modes de prise en charge de leur problème que l’approche répressive […].
Une deuxième critique courante réduisant l’abolition à la « loi du plus fort » insinue que la disparition des institutions pénales favoriserait les méfaits (économiques, financiers, environnementaux, etc.) des puissants ou des élites. Il convient ici de rappeler que les élites bénéficient déjà d’un abolitionnisme sélectif de fait. La plupart des préjudices qu’elles causent sont dépénalisés, font l’objet de procédures de conciliation ou ne sont tout simplement pas criminalisés. Pour autant, d’un point de vue abolitionniste, la solution ne réside jamais dans la criminalisation des auteurs de méfaits, quel que soit leur statut social.
Certes, l’abolition du système pénal pourrait, sous certaines conditions (par exemple de nouvelles technologies sécuritaires garantissant la protection des capitaux et de la propriété), être compatible avec une société (néo)libérale, où régnerait la « loi du plus fort » et où prospéreraient le vigilantisme et les méfaits des puissants. Mais l’abolitionnisme ne se contente pas de l’abolition, qui n’est même pas son ultime objectif. Comme le souligne Ruth Wilson Gilmore, le projet de l’abolition, dans son sens abolitionniste, constitue moins une « absence » qu’une « présence ». Celle-ci n’est qu’un point de départ stratégique et un horizon jamais atteint qui permet de repenser les préjudices, leurs causes et leurs modes de résolution, et de reconsidérer collectivement ce que l’on désigne généralement par les termes « protection », « sécurité » ou « responsabilité ». Ainsi l’abolitionnisme est radicalement incompatible avec les projets de société de type libertarien, qui radicaliseraient le régime d’inégalité économique et d’injustice sociale actuel, basé sur une éthique de la responsabilité individuelle. Il s’agit d’un projet global émancipateur qui, allant bien au-delà du règlement des conflits, cherche à inventer une nouvelle société.
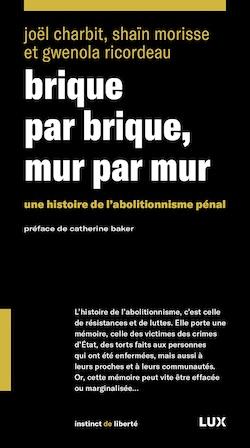
L’extrait ci-dessus est tiré de l’excellent ouvrage Brique par brique, mur par mur. Une histoire de l’abolitionnisme pénal, écrit par Joël Charbit, Shaïn Morisse et Gwenola Ricordeau (2024). Lecture chaudement recommandée.
